Dans le flou au musée de l'Orangerie en mai 2025
<< Au vrai, on ne voit rien. Rien de précis. Rien de définitif. Il faut en permanence accommoder sa vue. >>
Grégoire Bouillier, Le Syndrome de l'Orangerie, 2024
Ce constat, c'est celui que nous faisons tous, en premier lieu, lorsque nous contemplons le grand cycle des Nymphéas de Claude Monet. L'exposition propose d'explorer cette dimension de l'œuvre tardif du peintre comme une clé de lecture d'un pan entier de la création plastique moderne et contemporaine.
C'est en effet sur les ruines de l'après-Seconde Guerre mondiale qu'une esthétique du flou s'enracine véritablement et se déploie. Le principe du discernement, qui prévalait depuis longtemps en art, apparaît alors profondément inopérant. Devant l'érosion des certitudes du visible, et face au champ de possibles qui leur est ouvert, les artistes proposent de nouvelles approches et font leur matière du transitoire, du désordre, de l'inachevé, du doute... Prenant acte d'un bouleversement profond de l'ordre du monde, ils font le choix de l'indéterminé, de l'indistinct et de l'allusion. Leurs œuvres s'affranchissent de l'injonction au net et accordent une place plus large à l'interprétation du regardeur.
Insaisissable par essence, le flou nous invite à un pas de côté, à cesser de vouloir constamment faire le point et à explorer la réalité sous de nouvelles modalités. Dès lors, il se révèle le moyen privilégié d'expression, par les artistes, d'un monde où la visibilité se brouille et où l'instabilité règne, aujourd'hui plus que jamais.
Claude Monet (1840-1926)
Le Bassin aux nymphéas, harmonie rose
1900
Huile sur toile
Paris, musée d'Orsay
PROLOGUE
L'esthétique du flou existe bien avant la période moderne. Le sfumato de la Renaissance qui, par la superposition de fines couches de peinture transparente donne au sujet des contours imprécis, en est le lointain parent. Le mot, issu du latin flavus, n'apparaît cependant qu'en 1676 sous la plume de l'historien Félibien pour exprimer la douceur d'une peinture. Cette notion vient nuancer le principe d'une représentation fondée sur la clarté de la ligne. À la fin du XIXe siècle, l'impressionnisme marque un véritable tournant, poursuivant la voie qu'avait ouverte la peinture de William Turner avec ses compositions brouillées. Le flou y culmine, au point que la figure se dissout.
Dans le même temps, la photographie naissante, procédé mécanique par essence, affirme la subjectivité de l'auteur grâce au flou. Cette affirmation de la vision de l'artiste trouve un écho dans les créations symbolistes de ses contemporains. En explorant leur moi intérieur, ceux-ci révèlent par le trouble ce que la vision nette dissimule d'ordinaire à la conscience.
Les œuvres présentées ici évoquent les différentes facettes. de ce moment fondateur. L'art contemporain y prend déjà place, dialoguant notamment avec les miroirs liquides du bassin aux Nymphéas de Monet.
Joseph Mallord William Turner (1775-1851)
Paysage avec une rivière
et une baie dans le lointain ou Confluent de la Severn et de la Wye
Vers 1845
Huile sur toile
Paris, Musée du Louvre, Département des Peintures
Georges Seurat (1859-1891)
La Voilette
Non daté
Crayon Conté
Paris, musée d'Orsay
Edvard Munch (1863-1944)
L'Œil malade de l'artiste. Nu agenouillé avec un aigle
1930
Aquarelle sur papier
Oslo, Munchmuseet
Dans les années 1930, le peintre norvégien Edvard Munch est atteint d'une maladie oculaire. Une hémorragie de la rétine atteint son œil droit, alors qu'il souffrait déjà d'une acuité réduite à gauche. Il peint et note au jour le jour les effets de cette dégénérescence, intégrant les taches noires qui perturbent sa vision à ses compositions. L'artiste représente ici l'une des formes que prend l'angoisse de mort réveillée par sa maladie. Une tache floue, vision intériorisée de l'aigle du mythe de Prométhée, entourée d'un halo lumineux, vient attaquer une jeune femme agenouillée.
Eugène Carrière (1849-1906)
Portrait de Rodin
Vers 1900
Huile sur toile
Paris, musée Rodin, dépôt du musée d'Orsay
Auguste Rodin (1840-1917) Dernière vision, L'Étoile
du matin ou Avant le naufrage
1902 Marbre
Paris, musée Rodin
À partir du milieu des années 1890, le sculpteur Auguste Rodin fait évoluer son esthétique, floutant les contours de ses marbres, falsant vibrer la matière. Comme Eugène Carrière en peinture, comme Edward Steichen dans ses tirages photographiques, il semble voir désormais toute chose comme «à travers un imperceptible volle». Ce bas-relief d'un symbolisme onirique, qui allie l'inachevé (non finito) et le sfumato (rendu vaporeux des contours) est un hommage au poète Maurice Rollinat. Des mains disproportionnées semblent surgir du bloc de marbre, cachant les yeux d'un saint Jean-Baptiste en proie à ses visions intérieures.
Sigmar Polke (1941-2010)
Pasadena
1968
Huile et peinture acrylique sur toile
Paris, Centre Pompidou
Musée national d'Art moderne / Centre de création industrielle
Cette peinture est tirée d'une photographie de la première mission Surveyor (1966-1968) destinée à capturer des images de la surface lunaire. En imitant la trame de l'image telle qu'elle a été diffusée dans la presse, Polke tourne en dérision le choc de cette vision qui ne montre rien. L'oeuvre joue avec humour du décalage entre la perte de repères et la précision millimétrique de la légende explicative: <<la pierre au premier plan à gauche sur l'image est haute de 15,0 cm et large de 30,8 cm». Le flou résultant de l'agrandissement de ce cliché de faible qualité témoigne ici de la volonté de l'artiste de sortir l'image médiatique de son immédiateté.
AUX FRONTIÈRES DU VISIBLE
L'esprit humain cherche sans cesse à dissiper le flou. Symptômes de notre malaise devant un réel incertain, nos «qu'est-ce que...?>> ont remplacé les « pourquoi ?» de notre enfance. Ce souci de mise en ordre du monde se heurte toutefois au risque d'en figer le sens. Le flou au contraire se nourrit de notre expérience, qui s'étale dans la durée, dans l'épaisseur du monde.
En jouant de ses effets, les artistes questionnent nos modes de perception, proposent de revenir à la source du regard, et nous poussent ainsi à nous défaire d'une lecture univoque du réel. Ils interrogent les lisières du visible, reprenant le vocabulaire de l'imagerie scientifique, de la vision de l'inframince à l'immensité du cosmos (Gerhard Richter, Sigmar Polke ou Thomas Ruff). Ils font vaciller les repères traditionnels de la représentation, jouant de l'indistinct plutôt que de l'opposition entre figuration et abstraction (Mark Rothko, Hiroshi Sugimoto, Hans Hartung). Ils mettent à l'épreuve le regardeur en stimulant son acuité visuelle avec malice, en reprenant la circularité de la rétine dans leurs œuvres en forme de cibles (Wojciech Fangor, Ugo Rondinone, Vincent Dulom).
Thomas Ruff (né en 1958)
ma.r.s.01_III
2011
Tirage chromogène sous Diasec
Düsseldorf, courtesy de l'artiste et galerie David Zwirner
Cette œuvre appartient à une série que l'artiste, passionné d'astronomie, consacre à Mars. Il travaille d'après des photographies haute résolution de la surface de la planète, prises par un satellite de la NASA. Si l'oeil peine à lire cette image, c'est que le photographe l'a ensuite retouchée numériquement par compression et ajout de couleurs, réduisant ainsi sa qualité. Sous l'apparence de la réalité, cette représentation n'est que la vision imaginaire et fantasmée d'une planète qui reste inaccessible aux regards humains.
Ugo Rondinone (né en 1964)
N°42
VIERZEHNTERJANUARNEUN- ZEHNHUNDERTDREIUNDNEUNZIG
1996
Acrylique sur toile
Dunkerque, Frac Grand Large - Hauts-de-France
Wojciech Fangor (1922-2015)
N 17
1963
Huile sur toile de jute
New York, The Museum of Modern Art Don de Beatrice Perry, Inc., 1965
Claire Chesnier (née en 1986)
140223
2023
Encre sur papier
Paris, collection Claire Chesnier, courtesy Galerie Ceysson & Bénétière
Le travail de Claire Chesnier donne à voir la couleur comme événement. Devant ses oeuvres, nous faisons l'expérience d'une perception sensible du monde, comparable à celle que nous pourrions faire en recouvrant la vue après une cécité passagère. Le flou apparaît dès lors comme moyen de saisir, dans la durée, l'immensité ondulatoire de l'atmosphère au gré des palpitations du temps qu'il fait et du temps qui passe. Abstraction colorée et paysage de lumière vibrante, sa peinture est tout à la fois l'héritière des champs colorés de Rothko et une forme d'incarnation visuelle de la poétique de Mallarmé: "ce à quoi nous devons viser surtout est que, dans le poème, les mots (...) se reflètent les uns sur les autres jusqu'à paraître ne plus avoir leur couleur propre, mais n'être que les transitions d'une gamme."
Vincent Dulom (né en 1965)
Hommage à Monet
2024
Jet d'encre sur toile (unique)
Collection de l'artiste
Vincent Dulom produit ses peintures en déposant sur la toile, en un unique passage, une pellicule de pigments par le biais d'une imprimante. Ce procédé produit un halo qui émerge à la surface du support en offrant d'infimes variations vibratoires. Au gré de ses tentatives d'accommodation, l'oeil voit des nappes colorées apparaître, des nuances chromatiques se préciser, une dissipation progressive de la forme advenir.
Mark Rothko (1903-1970)
Untitled
1948
Huile sur toile
Riehen/Bâle, Fondation Beyeler, collection Beyeler
Cette toile est réalisée peu après le passage de l'artiste à l'abstraction. Rothko y superpose des couches de peintures diluées, jouant sur l'intensité des couleurs, l'irrégularité des formes, et leur distinction avec le fond de la toile. Le peintre propose ainsi une expérience à la fois perceptive et corporelle, celle de l'observation sur le temps long, pour saisir l'atmosphère, mouvante et nuageuse, de la peinture. «J'utilise des bords estompés. J'ai dit qu'ils sont atmosphériques, donc ils suscitent une réaction atmosphérique. » Le flou procède ici pleinement de son cheminement vers le color field (champ coloré
Claudio Parmiggiani (né en 1943)
Polvere
1998
Fumée et suie sur panneau
Dijon, collection Frac Bourgogne
Le travail de Parmiggiani s'inscrit dans la lignée de l'Arte Povera, mouvement italien des années 1960 dont les moyens de création s'opposent à la logique productiviste de la société de consommation. En créant un feu contrôlé, l'artiste laisse ici se former une fine pellicule de suie sur les étagères de sa bibliothèque recouverte d'ouvrages. Une fois le mobilier enlevé, se dessine en négatif une empreinte aux contours vaporeux. "Il ne restait que les ombres des choses, presque les ectoplasmes de formes disparues, évanouies, comme les ombres des corps humains vaporisés sur les murs d'Hiroshima."
L'érosion des certitudes
C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que l'on voit véritablement se déployer la dimension proprement politique de l'esthétique du flou. Devant l'érosion des certitudes, les artistes, de Zoran Mušič à Gerhard Richter, prennent acte d'un bouleversement profond de l'ordre du monde et s'emparent du flou comme d'une stratégie nécessaire.
Après la découverte des camps de concentration, face à l'impossi- bilité de représenter l'irreprésentable, le flou vient voiler une réalité que le regard ne peut soutenir. Dans le même temps, il vient aussi nous forcer à faire la mise au point, nous obligeant de ce fait à nous. attarder sur l'image, à regarder cette réalité en face. Remettant en question le statut et la valeur de l'image, les artistes proposent une vision à la fois poétique et désenchantée des tragédies qui ont traversé l'histoire du XXe siècle, jusqu'aux crises les plus actuelles.
Le flou se révèle ainsi tout à la fols une puissance d'aveuglement participant d'une mécanique de l'oubli, et une manière de témoigner, malgré tout, des atrocités de l'Histoire diffusées par l'image médiatique.
Bracha Lichtenberg Ettinger (née en 1948)
Medusa (series)
2012
Encre de Chine, pigments et cendres photocopiques, aquarelle, crayon de couleur et craie sur papier
Courtesy de l'artiste
Bracha L. Ettinger est née à Tel-Aviv en 1948 dans une famille juive ashkenaze originaire de Pologne. Elle travaille par séries, à partir de reproductions d'archives - souvent issues des camps concentrationnaires sur lesquelles elle applique plusieurs couches d'encre et d'aquarelle: la trame ainsi formée obstrue la lecture de l'image originelle qui s'évanouit dans la poudre de toner de photocopieuse qui recouvre l'ensemble, telle une poussière de cendres. Dans sa série «Eurydice», l'artiste propose un travail mémoriel au travers du mythe d'Orphée, empêché de se retourner dans son voyage retour des Enfers au risque de faire mourir une seconde fois son épouse Eurydice. En donnant à voir ce processus d'effacement de la mémoire, l'artiste choisit de peindre l'Histoire au présent.
Thomas Ruff (né en 1958)
jpeg ny01
2004
Tirage chromogène sous Diasec, AP (edition of 3, 2AP) Courtesy de l'artiste et David Zwirner
Christian Boltanski (1944-2021)
École de Grosse Hamburgerstrasse (Les enfants cachés)
2005
Huile sur tirage argentique noir et blanc Paris, collection de Bueil & Ract-Madoux
Artiste plasticien français né en 1944 d'un père juif ayant échappé à la déportation, Christian Boltanski questionne la mémoire
individuelle et collective en exploitant la dimension funèbre propre à la photographie: «Dans toute photographie, ce qui est photographié est un spectre: il y a retour du mort.» (Roland Barthes). Dans ses livres comme dans cette œuvre, Boltanski recourt à des portraits anonymes flous obtenus souvent par reproduction de reproduction. Ce procédé brouille l'identité des sujets et renvoie l'image universelle d'une humanité dans laquelle chacun peut se reconnaître. Dans ses livres, les images d'archives évoquant la Shoah sont utilisées sans légendes, et présentées dans un ordre aléatoire. Il est dès lors impossible pour le regardeur de distinguer victimes et criminels, à l'image de ce que Primo Levi nomme «la zone grise»>, cette «zone indéterminée entre le bien et le mal»
Krzysztof Pruszkowski (né en 1943) Quinze miradors du camp d'extermination de Majdanek (Pologne)
1992
Fotosynteza, sels d'argent sur papier Paris, collection de l'artiste
Le photographe Krzysztof Pruszkowski développe, à partir de 1975, un nouveau procédé qu'il appelle «photosynthèse ». Il photographie plusieurs fois le même motif, en le superposant avec un léger écart, pour créer une image synthétique. Il produit ainsi, par ce léger chevauchement, une image vibrante, presque spectrale, qui modifie la perception de la réalité et la trace que notre mémoire va en conserver. Agissant comme une lutte contre l'oubli, le mirador ici représenté met à distance ce symbole ultime des camps de la mort et questionne le statut de ces images tellement vues qu'elles en deviennent impossibles à voir.
Gerhard Richter (né en 1932)
September
2005
Huile sur toile
New York, The Museum of Modern Art
Don de l'artiste et Joe Hage, 2008
Cette toile représente la collision du premier avion sur la tour nord du World Trade Center, le 11 septembre 2001 à New York. Bien que Richter s'appuie sur les images très médiatisées de l'attentat, l'œuvre est presque illisible. Un voile de peinture recouvre la surface, aplatit les formes et en atténue les contours: l'évanouissement de ces symboles de l'empire américain est en marche. Cette vision reprend les codes de l'ère médiatique et retranscrit, en peinture, le brouillage des écrans de télévision mal réglés. Le flou qui s'en dégage met hors de portée du spectateur l'assouvissement de son désir de voir et renforce la dimension tragique de cette peinture d'Histoire au présent.
Philippe Cognée (né en 1957)
Métamorphose I
2011
Peinture à la cire sur toile
Paris, collection particulière
La technique singulière de Philippe Cognée consiste à reproduire des images photographiques en utilisant une peinture encaustique de pigments mêlés à de la cire d'abeille. La cire est ensuite fondue par endroits à l'aide d'un fer à repasser, les formes se dissolvent et l'image se floute, laissant apparaître le motif initial dans une morphologie nouvelle et trouble. Le sujet - souvent banal - bascule alors vers une autre représentation qui se dote d'une dimension tragique. Appartenant à une série plus large consacrée aux architectures contemporaines, Métamorphose I propose une vision précaire de nos environnements urbains surpeuplés, image métaphorique d'un monde au bord de l'effondrement.
Miriam Cahn (née en 1949)
das schöne blau
2008+28.05.2017
Huile sur toile
Londres, Tate
Acquise grâce aux fonds du Joe and Marie Donnelly Acquisition Fund 2020
Artiste activiste et féministe, Miriam Cahn envisage son œuvre comme une caisse de résonance des conflits contemporains et de leur médiatisation. Ici, des figures humaines diaphanes affrontent silencieusement une situation dans laquelle leur corps se dissout, exposées dans toute leur fragilité. Les personnages se fondent dans un environnement aquatique sur le point de les aspirer dans les profondeurs. Commencé en 2008, ce tableau est inspiré par les images de migrants fuyant l'Afrique du Nord en traversant la Méditerranée au péril de leur vie. L'artiste a repris sa toile en 2017, date à laquelle quelques 3100 migrants se noient en tentant de rejoindre l'Europe. Miriam Cahn donne alors forme à une réalité perdue dans le flux des images volatiles de l'actualité et qui nous regarde, pourtant, droit dans les yeux.
Luc Tuymans (né en 1958)
Sniper
2009
Huile sur toile
Collection Scott Mueller
Peintre de la banalité du mal, l'artiste belge Luc Tuymans travaille d'après des images glanées dans les médias. Sa palette de couleurs, comme surexposées, donne un sentiment d'images délavées, lessivées par le temps, affaiblies par la mémoire. La touche appliquée à l'horizontale se fait invisible. Les glacis, fines couches de couleurs transparentes superposées, fonctionnent comme autant de strates de représentations s'interposant entre la chose et la perception que l'on en a. Sniper trouve sa source dans une vidéo trouvée sur Internet montrant un tireur d'élite tuant un soldat américain en Irak. En cadrant au premier plan sur la cible du viseur (du tueur, du photographe), Tuymans met à distance la scène «visée », noyée dans le flou, pour faire le point sur cette prothèse de l'oeil: «Je ne veux pas faire de l'art pour l'art mais une peinture d'Histoire, ou plutôt une peinture de mémoire et de trauma (...). Ce qui m'intéresse, c'est le résidu des choses. Ce qu'on voit une fois qu'on a fermé les yeux. >>
Alfredo Jaar (né en 1956)
Six Seconds
2000
Impression jet d'encre pigmentaire New York, courtesy de l'artiste
Artiste, architecte et réalisateur chilien, Alfredo Jaar questionne dans son travail la possibilité de produire une œuvre d'art à partir d'événements déformés par leur médiatisation. Six Seconds est la dernière pièce d'un projet de plus de six ans consacré au génocide rwandais. «C'est l'image d'une jeune fille de dos. Cette jeune fille avait été témoin de la scène où son père et sa mère se font tuer à coups de machette. J'avais pris un rendez-vous avec elle pour qu'elle me raconte son histoire. Mais quand elle est arrivée, elle a changé d'avis (...) Au moment où elle se retourne et rebrousse chemin, je saisis mon appareil et prends une photo sans vraiment faire le point, d'où le flou. Cette image floue représente mon incapacité à raconter l'expérience de cette femme ou l'expérience du Rwanda - l'impossibilité. >>
Y.Z. Kami (né en 1956)
Hands
2019
Huile sur toile de lin
Courtesy de l'artiste et Gagosian
Untitled (Hand) I
2013
Huile sur toile de lin
Courtesy de l'artiste et Gagosian
Né à Téhéran en 1956, Y.Z. Kami vit et travaille à New York depuis 1984. Dans son œuvre peint, réalisé à partir de ses propres photographies, il explore le flux entre matière et esprit et cherche à évoquer le sentiment d'une présence, «une image qui respire». Ses toiles, à la surface mate et aux contours Indécis, semblent troublées, comme par un effet de brouillard. Les figures. telles des présences fantomatiques, convoquent une dimension spirituelle Ces deux peintures prennent leur source dans des fragments de portraits de proches: la main d'une femme Indienne détentrice d'une pratique ancestrale de danse sacrée, et les mains jointes d'un moine bouddhiste
Léa Belooussovitch (née en 1989) Sequoia National Forest, Californie, États-Unis,
27 septembre 2021, série Brasiers
2023
Dessin au crayon de couleur sur feutre de laine
Bruxelles, collection particulière
Léa Belooussovitch réalise des dessins aux crayons de couleur sur feutre de laine à partir d'images médiatiques. Appliquée
sur ce matériau textile isolant, la couleur se répand en profondeur, sans limite apparente, et crée un trouble dans l'oeil comparable
à celui d'une nuée ardente en train de tout consumer sur son passage. La série Brasiers à laquelle cette œuvre appartient est consacrée aux méga-feux qui ont ravagé la planète depuis 2016; elle met en évidence la question de l'urgence climatique. A travers ses compositions presque abstraites, l'artiste témoigne et alerte du lent désastre en cours.
Gerhard Richter (né en 1932)
Blumen (815-1)
1994
Huile sur toile
Nîmes, Carré d'Art, Musée d'art contemporain
Nan Goldin (née en 1953)
1st Days in Quarantine, Brooklyn, NY
2020
Impression jet d'encre pigmentaire
Paris, galerie Gagosian
La photographe et activiste américaine Nan Goldin a toujours affronté dans son œuvre, sans détourner le regard mais en leur donnant forme, la douleur et l'angoisse. Ce bouquet posé sur une table devant une fenêtre possède pourtant le charme désuet des natures mortes classiques. Le flou qui y règne semble y apporter une touche de poésie nostalgique. Si ce n'étaient ces deux dessins de crânes, symboles de danger, discrètement apposés sur un papier collé à la vitre. Nous sommes tous mortels, nous rappelle cette image, moment suspendu, volé par l'artiste alors qu'elle voyait les fleurs se faner, pétale par pétale, pendant qu'elle était confinée lors de la première vague de COVID-19
Mame-Diarra Niang (née en 1982)
Morphologie du rêve #6
2021
Impression jet d'encre sur papier métallique photo rag. édition de 7-2AP
Collection Mame-Diarra Niang, courtesy Stevenson, Le Cap / Johannesbourg / Amsterdam
Artiste et photographe française, Mame-Diarra Niang explore dans ses photographies récentes l'identité du corps noir, refusant toute tentative de définition ou de narration qui reposerait sur les siècles d'histoire de la représentation occidentale. Elle cherche ainsi à rabstraire, à travers ce qu'elle appelle des formes de non-portraits. Dans cette série commencée pendant le confinement, l'artiste photographie et rephotographie son écran, chaque nouveau cliché broulant davantage les contours, au point de transformer les corps en taches colorées. Peu à peu, le sujet disparaît, le moi se dissout dans ce flou spectral, comme un territoire fait de souvenirs et d'effacements bien conservés.
Eva Nielsen (née en 1983)
Scope (6)
2021
Acrylique, encre de Chine sur toile et organza imprimé Paris, LVMH métiers d'art résidence artistique tanneries Roux et Twinpix
Artiste franco-danoise, Eva Nielsen explore la perméabilité entre peinture et photographie par l'usage de la sérigraphie sur toile. Dans sa série Scope, l'artiste joue des différents sens de ce mot, dont l'étymologie renvoie au fait d'observer, mais aussi d'imaginer, avant de signifier le but à atteindre, la cible. Sur une photographie de famille floue, une femme, tenant des jumelles, guide le regardeur vers le hors-champ de l'image. La superposition des couches de peinture, puis l'application d'une toile d'organza sérigraphiée tendue, accentuent le flou initial de l'image.
Alberto Giacometti (1901-1966)
Figurine
Vers 1947
Bronze
Paris, Fondation Giacometti
Gerhard Richter (né en 1932)
I.G.
1993
Huile sur toile
Barcelone, «la Caixa » Foundation Contemporary Art Collection
Hervé Guibert (1955-1991)
Autoportrait
Vers 1990
Tirage gélatino argentique
Paris, collection Marc Donnadieu
Écrivain, photographe, cinéaste, critique, Hervé Guibert investit diverses formes d'expression sans en hiérarchiser l'importance. Dans son œuvre photographique, il s'exerce régulièrement à l'autoportrait, parfois mis en scène, et ce jusqu'aux derniers jours sombres de sa vie consumée par le sida.
Ce cliché réalisé peu avant sa disparition fait écho aux réflexions de l'auteur dans L'Image fantôme (1981). Il se livre ici au regard de l'appareil. Pourtant, le voile qui recouvre son visage et le rend flou au point d'en effacer les traits, renvoie à cette double pulsion de désir et de mort qui fonde sa pratique photographique
Mircea Cantor (né en 1977)
Unpredictable Future
2015
Calsson lumineux
Paris, collection particulière
Artiste d'origine roumaine, Installé en France à la fin des années 1990, Mircea Cantor se définit comme «artiste du monde».
Il interroge les fallles de notre société contemporaine au travers d'une œuvre poétique plurielle.
Dans Unpredictable Future, Il photographie la trace tremblante laissée par son dolgt sur une vitre embuée. Du même coup, il conserve à dessein la petite faute d'orthographe en anglais (« unpredicteble») du jeune artiste. De ce «futur Imprévisible», Il propose avec autodérision d'accepter le sort, rendant pérenne un acte éphémère, et fixant sur la pellicule l'Instabilité du futur, entre espoir et inquiétude: «De nos jours, nous recherchons la transparence et la prévisibilité dans tout (...) Nous voulons prouver, savoir, être certains. Il y a une Inflation de la valeur de la certitude; nous avons besoin du contraire. C'est là que les artistes peuvent jouer un rôle».
















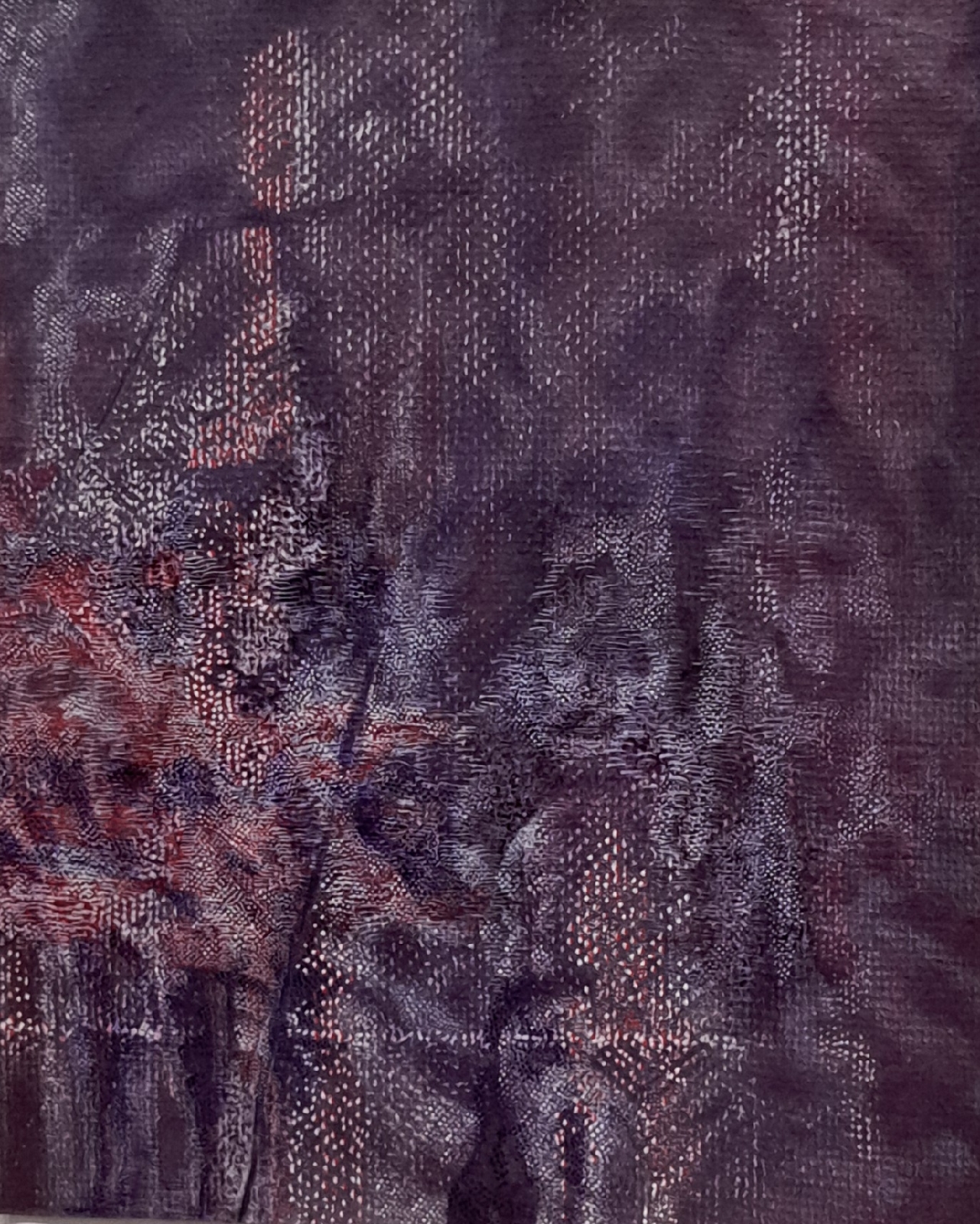






















Commentaires
Enregistrer un commentaire